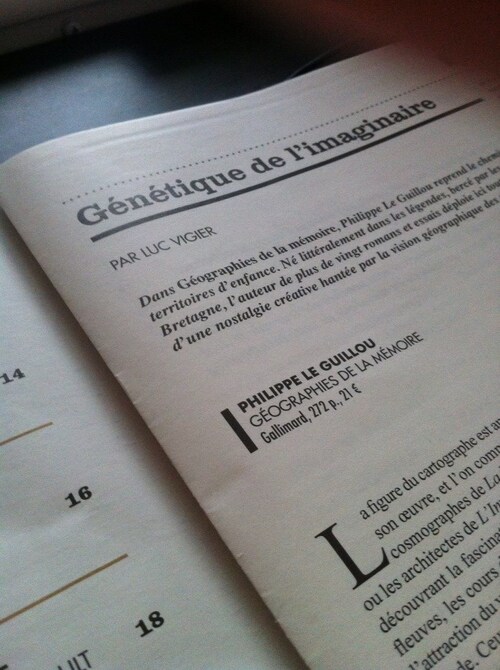-
Par Littératurefrançaise le 16 Octobre 2019 à 16:52
Programme détaillé ci-dessous:
Jeudi 21 novembre
Amphithéâtre Dussane
45, rue d’ULM (ENS)
9h30 : Luc Vigier – Ouverture du colloque
Matinée – Modérateur : Luc Vigier
10h00 : Sylvie Guichard – « La "ligne invisible" d’une remontée vers l’origine dans quelques œuvres de Philippe Le Guillou ».
10h40 : Jean-Loup Champion – « Trente-cinq ans. Éditer Philippe Le Guillou »
11h20 : Thomas Anquetin – « Figure du double et intermission du tiers dans les romans de Philippe Le Guillou ».
13h-14h15 : déjeuner des orateurs
Après-midi – Modérateur : Jean-François Frackowiak
14h30 : Jean-Baptiste Legavre – « La Bretagne illustrée de Philippe Le Guillou ».
15h10 : Louis Baladier – « Fonctions de paysages dans l’œuvre de Philippe le Guillou".
15h50 : Dimitri Soenen – « Construction et déconstruction dans l’œuvre de Philippe Le Guillou ».
16h30 : Matthieu Dorval – « L'influence réciproque des mots et de la matière ».
Intervention d’Eric Tanguy, compositeur.
Vendredi 22 novembre
9h30 : Luc Vigier, ouverture de la seconde journée
Matinée – Modérateur : Sylvie Guichard
10h : Daniel Oster – « L’esprit géographique de l’œuvre de Philippe Le Guillou. L’exemple de L’intimité de la rivière ».
10h40 : Jean-François Frackowiak – « La sainteté dans les derniers récits de Philippe Le Guillou. »
11h10 : Luc Fraisse – « Où va le roman ? Les réponses de Philippe Le Guillou »
13h-14h15 : déjeuner des orateurs
Après-midi – Modérateur : Louis Baladier
14h30 : Claudine Glot – « Quelques souvenirs de voyages anciens ».
15h10 : Guillaume Tomasini – « Corps et sérialité dans l’œuvre de Philippe Le Guillou ».
15h50 : Alexandre Postel – « Philippe Le Guillou en peintre d’intérieur ».
16h30 : Intervention d’Eric Tanguy, compositeur
Luc Vigier et Philippe Le Guillou – conclusion à bâtons rompus
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Littératurefrançaise le 4 Avril 2016 à 00:18
A lire dans La nouvelle Quinzaine littéraire de début avril (n°1148):
"Génétique de l'imaginaire", consacré à Géographie de la mémoire de Philippe Le Guillou.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Littératurefrançaise le 2 Mai 2015 à 18:22
 Sur Le Donjon de Lonveigh
Sur Le Donjon de LonveighLuc Vigier, Université de Poitiers / ITEM (CNRS)
Ecrire et peindre
Il faut aux romans de Philippe Le Guillou une lumière d'atelier, des tracés énergiques et des couleurs préparées. Dans la solitude démiurgique du Donjon de Lonveigh, le regard en polyptique organise la matière de Bretagne, de Venise et d'Irlande, plonge dans les tourbières, exhume des ossements, éprouve l'art brut des sensations, s'initie. La volonté de vision émet ici comme un phare depuis l'isolement cellulaire où s'abrite la conscience. Rien de réel – tout est rêve, fantastique ou cauchemar – rien pourtant de plus concrètement posé sur la toile. La page posée sur chevalet trouve ses repères inchangés depuis L'inventaire du vitrail : la main au pinceau reprend la glaise, la rouille et les rouges, les macérations brunes, les sables blonds, les algues de cendre, simple répartition préalable des éléments sur la palette, projection de reliefs sur la structure et prélude à l'éclat. L'écriture sera donc dissémination des motifs, cristallisation alchimique des substances, hauts remparts d'un sujet perdu dans le Grand Temps de la réminiscence. Peindre contre l'angoisse, la contradiction et la mort, c'est simultanément unifier ce qui se disperse, se disloque, capturer la mer et fixer le chaos. L'écriture romanesque de Le Guillou trouve dans ce dipositif mouvant une part de son étrangeté : projection de vitrail, toiles sanglantes et dynamiques, portraits de Saint-Sébastien sont autant de tableaux en abymes d'une ekphrasis inversée. La peinture décrit l'écriture dans ses processus, ses intensités, ses secousses telluriques, toujours au seuil de la dislocation et de l'abandon. Thomas Daigre, frappé de nostalgie, aurait pu devenir peintre mais c'est Florence, cette fille au nom d'Italie qui incarne la filiation et la transmission fécondée de l'art. Lieux de renaissance et de mémoire, les paysages d'Irlande, de Brest ou de Venise trouvent en cette gémellité de l'écrire et du peindre la source d'une énergie stylistique : comme soulevés par le regard, les roches et les liquides, les ciels, les vents et les végétaux, les pierres et les monuments se trouvent animés d'une force vitale répétitive, insistante, incantatoire, aux frontières de la scansion rituelle, de la prière et du chant. On atteint aux rivages de la musique où les personnages arpenteurs, tous issus d'une même matrice, intègrent en voix et en dessin le grand opéra du monde. Issues d'un regard fantasmé d'artiste et d'une fiction de tableau, les extases lyriques de Thomas Daigre font entendre une poésie testamentaire, un dit d'outre-tombe où s'amplifie la vie.
Théâtre de soi
Rien de plus vital et désirant que les figures morbides chez Philippe Le Guillou, où se débattent la curiosité cosmique, la folie créatrice et la dévoration jouissive des corps. Opaque d'acidité et d'autophagie, maudit par l'histoire, Thomas Daigre n'en reste pas moins cette force de rage et de vent que l'on vient visiter. L'écriture cherche ici, et souvent ailleurs dans l'œuvre romanesque, ses assises familières, ses rituels cadres et en tout se manifeste. Phrasés et personnages volontiers empruntés à Gracq, déambulations sablières vues chez Barbey d'Aurevilly, rythmique proustienne, figures récurrentes d'une mythologie personnelle (vieillard solitaire, demeure inondée, cryptes diverses, labyrinthe, silence et chaos), dispositif narratif aux « je » emboîtés, la plume fait ses gammes, se refonde et se ressource en mille facettes initiatiques identifiables au premier coup d'oeil. Le dispositif s'exhibe, se démonte et s'analyse, se constituant en vaste réseau bruissant et conscient de ses modèles. Ce qui compte, c'est l'orchestration et les cycles organiques de cette composition qui s'affranchit d'un fil romanesque dont on perçoit assez vite la ténuité, comme si le récit basculait au profit de la scène du langage, constamment lancé et redécoupé. Le précipité chimique de la phrase, l'alcool des vertiges qu'est le whisky obsessionnel se chargent de lier le roman et la voix.
Sortir du chaos par le vertige, c'est justement ce que cherche l'auteur de cette œuvre continue qui va de L'Inventaire du vitrail aux Années insulaires en traversant le monumental Sept noms du peintre non sans évolutions notables, dont les racines plongent assez profondément dans une scénographie intime. Pas un personnage, pas une ruine, pas un objet qui ne se sente ici théâtralement exister : Daigre sait qu'il fait l'effet d'un vieil antiquaire aigri et porte son rôle dans son patronyme, manipule un majordome metteur en scène, tout comme Florence joue au peintre dans le regard du visiteur conscient d'être son voyeur, et les ruines savent qu'elles sont là en totems symboliques d'une ritualisation du monde. Le roman se montre comme scène où les textes comme les disascalies sont connues d'avance et l'on passerait ici assez facilement du roman au théâtre, au scénario, au drame filmé. Présente dans l'œuvre depuis les origines, y compris sous sa forme opérale, la dimension dramaturgique, qui se superpose aux liturgies personnelles comme aux véritables cérémonies, vaut aussi pour le narcissisme radical d'une écriture de soi qui passe par ce regard structuré en boucle sous les yeux du lecteur. La pyschanalyse, comme la mythocritique, y trouveraient force matière à réflexion, mais les enjeux de la psyché ne se disent ici que sous le voile d'un codage ritualisant qui va du plus subtil au plus tonitruant. Ce qui est crié ou chuchoté se structure comme une partition, une gamme, une syntaxe de douleur et de reconstruction : comment ne pas lire en effet dans ces installations que sont les romans de Philippe Le Guillou les processus de dépassement qu'incarnent la plupart des personnages, tous témoins en deuil, porteurs de fantômes, errants lamentables ou sublimes ? La plongée iniatique de Thomas Daigre – l'auto-baptême médiéval de la digue – modélise l'ensemble d'un suicide symbolique : l'écrivain se tisse en ses renaissances.
Politique du secret
Le roman de Le Guillou se structure ainsi en cycles de révélations et les secrets douloureux jaillissent à la moindre dalle soulevée, au plus secret des tabernacles, derrière la plus sombre des portes. Premier cycle, celui du père : ses figurations en grand-père, on voudrait dire en outre-père, vieillard et maître esthétique disent toute une filiation indirecte dont l'auteur parlera, sur un plan plus strictement autobiographique, dans Les Marées du Faou. La cérémonie d'adoubement, faite d'adoption réciproque, de reconnaissance et d'instinct, suit un processus parfaitement réglé d'initiation croisée : le vieillard quasiment momifié dans le repli et le renoncement retrouve ce qui le fonde et le déchire au contact d'un jeune éditeur parisien, s'engage dans un processus d'aveu et de confession par lequel il se révèle à lui-même, non sans douleurs, tandis que le témoin et scripteur voit ses certitudes vaciller et ses propres émotions envahir l'intimité d'une mémoire. Second cycle, celui de la mère : la figure maternelle, tutélaire, autoritaire, impérieuse, dispersée en personnages féminins de feu et de folie, irrigue l'espace mental de manifestations tour à tour fécondantes (Florence) ou dérisoires (Susan). Dans le prolongement, on découvre la difficile assomption d'une érotique homosexuelle au moment même où se joue une crise mystique sans précédent chez l'adolescent, dont les strates constitutives sont évoquées, décalées et cryptées, dans les émois ultérieurs de Thomas Daigre. Troisième cycle, celui de l'Histoire : connecté à la Bretagne par d'étranges rizhomes religieux, les zones noires du fascisme et du nazisme hantent Thomas Daigre comme bien d'autres « écrivains-prêtres » après lui. Brieu-Drieu La Rochelle, lié souterrainement au suicide de Montherlant (dont il sera question dans La Consolation et dans les récentes Années insulaires) renvoie Daigre à cette frange infâme de la collaboration française, à la mise sous tutelle de la NRF, au suicide de Drieu en 44, dont il est le témoin fictif, l'amant impuissant à éviter le drame. Le croisement de ces lignes déconcerte : c'est qu'elles sont le tissu d'une crise plus profonde donnant naissance à des êtres scindés, des êtres doubles, en quête désespérée d'unité. Les figures maudites et séparées du monde, comme les retours de relégation sont aussi miroirs d'une histoire française de la littérature, qui a fait ses choix, et servent ici de métaphores à l'ambiguïté, au paradoxe et à l'aveuglement.
Fantastique des sublimations
Le Donjon de Lonveigh joue des frontières et des lisières, pose les problèmes sur la tranche, suture ce qui se fracture, décale les polarités et fait entrer les fantômes. Thomas Daigre, le Donjon et le Majordome avec leurs faux airs de Bram Stocker et d'Edgar Poe préparent un fantastique bien plus complexe. L'alternance des voix narratives (Daigre / Editeur) installe très vite le double comme nécessité mais plus tard la double sonorité de la voix confessée et des pages du journal, elles-mêmes posées à côté des scènes vécues par le narrateur premier aboutissent à un feuilleté énonciatif où les personnages semblent tous émaner d'une même instance. On gagne ainsi à favoriser une lecture hallucinée ou légèrement schizophrène des récits de Philippe Le Guillou, d'où l'humour et l'ironie d'auteur ne sont jamais absents : de même que les églises communiquent avec les ateliers par de petites ouvertures, Florence est une partie de Thomas, qui ressemble à Frédéric qui rejoint l'image de Brieu et de Luigi au cœur d'un labyrinthe temporel incarné par le parc du Donjon. Sexes et mémoires s'entrechoquent dans l'interférence des temps et des espaces, dessinant les frontières en fissures. C'est dans ces ravines tourmentées que le langage du roman prend toute sa puissance de profération : les improvisations surréalistes de Thomas-Hor face à la mer, entre la violence physique d'un Maldoror et l'horror shakespearien, projettent le lecteur vers la matière orgasmique du poème en prose. Dans le silence des salons et des chambres, la temporalité est ainsi toujours celle de la crise : les personnages hurlent, saignent, se désirent, se confondent, s'absorbent, se quittent, installent dans le temps la tombe des ellipses, peuplent l'amitié naissante de départs inexpliqués, pour au bout du compte se figer en facettes foudroyées d'une même dimension humaine. C'est sans doute l'impérieux appel d'un nouveau dépassement qui font des romans de Philippe Le Guillou des labyrinthes esthétiques. Peinture, sculpture, musique, poésie, danse, architecture constituent une matrice sublimante qui ne cessera de se développer après Le Donjon, où les biseaux de couleurs tombés de vitraux annoncent la chambre d'Agam, récemment décrite dans Les Années insulaires : elle est ce roman de l'homme dans la diffraction des prismes.
Le Donjon de Lonveigh (1991)
Réédition Folio janvier 2015. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Littératurefrançaise le 19 Octobre 2014 à 09:34
L'oeuvre de
 Philippe Le Guillou occupe une place singulière dans le champ littéraire contemporain. Héritier de toute une tradition française et des postures d'écrivains qui lui sont associées, Philippe Le Guillou se réclame volontiers de Chateaubriand, de Stendhal, de Proust, de Malraux, de Montherlant et de Gracq. La tendance naturelle de cet écrivain le porte assez évidemment vers des écritures gravées, à la musicalité étudiée et au rythme architectural. Et si l'on se penche sur ses premiers romans, où se déversent les élans d'une parole intérieure portée à incandescence, c'est bien cette dimension musicale qui apparaît d'abord, avant que l'on découvre dans l'inscription du chant la matière première de toute l'oeuvre future, qui s'ancre dans les paysages du Finistère Nord, matière riche en souvenirs, en affections, en récits et rituels. Rien d'anecdotique dans cet attachement, si fortement revendiqué et repris, inlassablement, comme lieu du retour et du ressourcement. Les Marées du Faou, en 2003, ont explicité la référence autobiographique des signes disséminés dans les romans, qui fonctionnent souvent comme cellules de remémoration, mais étrangement, ce récit renvoie l'autobiographie à l'univers romanesque, se montrant presque plus efficace dans l'évocation des territoires des fictions d'enfance que les romans eux-mêmes où affleurent, comme filières géologiques érodées par les vents salés, des fragments de confessions ou des images primitives issues des premiers récits. Il s'agit d'autre chose: raconter sa vie n'a jamais été pour Philippe Le Guillou un objectif premier. Si l'oeuvre est parfois bruyante, forte, appuyée, redondante et ressassante, exhibant un monde particulierement itératif, l'homme est discret et ne s'étend guère sur les émotions et les déchirures, si ce n'est dans des récits poignants comme Fleurs de tempête. Mais c'est aussi et chronologiquement d'abord dans la fiction et sous des masques multiples que les repères fondamentaux de l'imaginaire se disent et se cherchent, au sein d'un univers de symboles et de signes qui, pour être repris avec une constance étonnante de roman en roman, n'en déploie pas moins, d'année en année, un réseau considérable d'allusions structurantes qui font des terres originaires de Brest, du Faou ou de Rennes, une géographie mythologique qui puise abondamment dans la fascination sans limite, sans réserve et sans pudeur cette fois des rites religieux et des élans mystiques. On s'agace parfois, de cette densité, de ces reprises et l'oeuvre apparaît dès lors, malgré ses variations génériques assez marquées ces dernières années, comme une seule et même parole produite par un Récitant global, dominant personnage et auteur, figure théâtrale majeure d'un ensemble résolument narratif et chanté. L'attachement de Philippe Le Guillou à un christianisme revendiqué, non pas radical mais sincère envers lui-même, loin des compromissions du siècle et des effets de mode, pourrait de même renvoyer cette écriture aux atmosphères oubliées des romans de Bernanos. De fait, ce romancier, à l'abri de la maison Gallimard, marche à contre-courant, rejette le rejet religieux, accentue à chaque livre la force de cet engagement-là, écrit son deuxième roman sur la papauté (Le Pont des Anges, Gallimard, 2012), n'en démord pas, et embarque volontiers son lecteur, non sans humour et distance, dans l'exploration de domaines devenus obscurs. Rien de plus étranger à l'auteur de ce site qui ne perçoit pas tout à fait de la même manière les desseins du clergé contemporain. A vrai dire, et c'est un état d'esprit que les familiers des ambiances mystiques de Bretagne connaissent un peu, je ne suis pas certain que l'essentiel littéraire de l'oeuvre se situe dans l'adoration des prêtres, des papes aux carnations d'or cuit et des tabernacles enfouis aux creux des petites chapelles d'Armor. D'abord parce qu'il faudrait y ajouter d'autres figures, qui sont systématiquement l'envers, le contre-point ou la contre-marque des figures mystiques: ce sont les écrivains, puis les peintres, les cartographes, les dramaturges, les poètes qui abondent véritablement dans les romans de Philippe Le Guillou. C'est dans l'association des écrivains solitaires, exilés, vieillissants, enfermés et des statues mystiques que se lit la dualité féconde et singulière de cette écriture qui ne se referme pas. Les romans, nombreux, sont autant de tentatives d'une saisie simultanée du prêtre et de l'écrivain, ce clerc double, ou cette dualité clericale qui fonde en identité et en sens le désir d'écrire. Ensuite parce que cette projection explore, au-delà de la seule thématique des initiations, deux types de transgression: la transgression rituelle et régressive d'un contexte d'accélération et de futilités séculaires au profit d'une évolution spirituelle intemporelle et la transgression jouissive de cet enfermement vers l'affirmation extatique d'une existence ouverte au vivre. L'écriture se laisse habiter par ces mouvements contraires, sensible à l'intérieur des romans mais aussi d'une oeuvre à l'autre, et l'on peut inclure dans cet ensemble les essais, qui paraissent plus rarement, comme les repères esthétiques assez nets d'une vision du monde filtrée par l'art et son approche intuitive. C'est ce qui constitue peut-être la discipline de cette oeuvre, qui ne se veut pas seulement soumise aux impératifs transcendantaux et aux grandes orgues de Saint-Eustache. Il s'agit peut-être, au-delà d'une forme de syncrétisme anthropologique assez singulier, d'un exercice méditatif, qui semble reprendre d'anciens paradigmes littéraires et qui, sous les allures du disciple, révèle les éclats de voix d'un maître, non pas au sens de l'autorité et de l'orgueil, mais au sens pédagogique du terme. C'est qu'il y a ici un élan inextinguible d'explication et d'interprétation, donnant aux écrits de Philippe Le Guillou une dimension métapoétique assez déstabilisante, plaçant parfois involontairement le lecteur en situation d'écoute d'une analyse que le Récitant fait devant lui, le dépossédant de son autonomie, expliquant dans le texte même la grande prose du monde, et imposant au final dans le descriptif l'intégration du commentaire cylcique d'une anthropologie de l'imaginaire. Voir les signes ne relève dès lors pas de la seule herméneutique religieuse mais appartient pleinement à une archi-lecture de soi dont l'écriture romanesque serait l'expression, condamnée à se renouveler sans cesse. Le rythme de publication ferait ainsi partie intégrante du rituel, qui tenterait de saisir dans l'instant les scansions souterraines d'une temporalité indépendante, et l'on envisagera ici non seulement de revenir sur les étapes constitutives de cette singularité mais d'observer les inscriptions à venir. Les entretiens et les documents (manuscrits) présents sur le site précédent seront prochainement transférés sur cette page.
Philippe Le Guillou occupe une place singulière dans le champ littéraire contemporain. Héritier de toute une tradition française et des postures d'écrivains qui lui sont associées, Philippe Le Guillou se réclame volontiers de Chateaubriand, de Stendhal, de Proust, de Malraux, de Montherlant et de Gracq. La tendance naturelle de cet écrivain le porte assez évidemment vers des écritures gravées, à la musicalité étudiée et au rythme architectural. Et si l'on se penche sur ses premiers romans, où se déversent les élans d'une parole intérieure portée à incandescence, c'est bien cette dimension musicale qui apparaît d'abord, avant que l'on découvre dans l'inscription du chant la matière première de toute l'oeuvre future, qui s'ancre dans les paysages du Finistère Nord, matière riche en souvenirs, en affections, en récits et rituels. Rien d'anecdotique dans cet attachement, si fortement revendiqué et repris, inlassablement, comme lieu du retour et du ressourcement. Les Marées du Faou, en 2003, ont explicité la référence autobiographique des signes disséminés dans les romans, qui fonctionnent souvent comme cellules de remémoration, mais étrangement, ce récit renvoie l'autobiographie à l'univers romanesque, se montrant presque plus efficace dans l'évocation des territoires des fictions d'enfance que les romans eux-mêmes où affleurent, comme filières géologiques érodées par les vents salés, des fragments de confessions ou des images primitives issues des premiers récits. Il s'agit d'autre chose: raconter sa vie n'a jamais été pour Philippe Le Guillou un objectif premier. Si l'oeuvre est parfois bruyante, forte, appuyée, redondante et ressassante, exhibant un monde particulierement itératif, l'homme est discret et ne s'étend guère sur les émotions et les déchirures, si ce n'est dans des récits poignants comme Fleurs de tempête. Mais c'est aussi et chronologiquement d'abord dans la fiction et sous des masques multiples que les repères fondamentaux de l'imaginaire se disent et se cherchent, au sein d'un univers de symboles et de signes qui, pour être repris avec une constance étonnante de roman en roman, n'en déploie pas moins, d'année en année, un réseau considérable d'allusions structurantes qui font des terres originaires de Brest, du Faou ou de Rennes, une géographie mythologique qui puise abondamment dans la fascination sans limite, sans réserve et sans pudeur cette fois des rites religieux et des élans mystiques. On s'agace parfois, de cette densité, de ces reprises et l'oeuvre apparaît dès lors, malgré ses variations génériques assez marquées ces dernières années, comme une seule et même parole produite par un Récitant global, dominant personnage et auteur, figure théâtrale majeure d'un ensemble résolument narratif et chanté. L'attachement de Philippe Le Guillou à un christianisme revendiqué, non pas radical mais sincère envers lui-même, loin des compromissions du siècle et des effets de mode, pourrait de même renvoyer cette écriture aux atmosphères oubliées des romans de Bernanos. De fait, ce romancier, à l'abri de la maison Gallimard, marche à contre-courant, rejette le rejet religieux, accentue à chaque livre la force de cet engagement-là, écrit son deuxième roman sur la papauté (Le Pont des Anges, Gallimard, 2012), n'en démord pas, et embarque volontiers son lecteur, non sans humour et distance, dans l'exploration de domaines devenus obscurs. Rien de plus étranger à l'auteur de ce site qui ne perçoit pas tout à fait de la même manière les desseins du clergé contemporain. A vrai dire, et c'est un état d'esprit que les familiers des ambiances mystiques de Bretagne connaissent un peu, je ne suis pas certain que l'essentiel littéraire de l'oeuvre se situe dans l'adoration des prêtres, des papes aux carnations d'or cuit et des tabernacles enfouis aux creux des petites chapelles d'Armor. D'abord parce qu'il faudrait y ajouter d'autres figures, qui sont systématiquement l'envers, le contre-point ou la contre-marque des figures mystiques: ce sont les écrivains, puis les peintres, les cartographes, les dramaturges, les poètes qui abondent véritablement dans les romans de Philippe Le Guillou. C'est dans l'association des écrivains solitaires, exilés, vieillissants, enfermés et des statues mystiques que se lit la dualité féconde et singulière de cette écriture qui ne se referme pas. Les romans, nombreux, sont autant de tentatives d'une saisie simultanée du prêtre et de l'écrivain, ce clerc double, ou cette dualité clericale qui fonde en identité et en sens le désir d'écrire. Ensuite parce que cette projection explore, au-delà de la seule thématique des initiations, deux types de transgression: la transgression rituelle et régressive d'un contexte d'accélération et de futilités séculaires au profit d'une évolution spirituelle intemporelle et la transgression jouissive de cet enfermement vers l'affirmation extatique d'une existence ouverte au vivre. L'écriture se laisse habiter par ces mouvements contraires, sensible à l'intérieur des romans mais aussi d'une oeuvre à l'autre, et l'on peut inclure dans cet ensemble les essais, qui paraissent plus rarement, comme les repères esthétiques assez nets d'une vision du monde filtrée par l'art et son approche intuitive. C'est ce qui constitue peut-être la discipline de cette oeuvre, qui ne se veut pas seulement soumise aux impératifs transcendantaux et aux grandes orgues de Saint-Eustache. Il s'agit peut-être, au-delà d'une forme de syncrétisme anthropologique assez singulier, d'un exercice méditatif, qui semble reprendre d'anciens paradigmes littéraires et qui, sous les allures du disciple, révèle les éclats de voix d'un maître, non pas au sens de l'autorité et de l'orgueil, mais au sens pédagogique du terme. C'est qu'il y a ici un élan inextinguible d'explication et d'interprétation, donnant aux écrits de Philippe Le Guillou une dimension métapoétique assez déstabilisante, plaçant parfois involontairement le lecteur en situation d'écoute d'une analyse que le Récitant fait devant lui, le dépossédant de son autonomie, expliquant dans le texte même la grande prose du monde, et imposant au final dans le descriptif l'intégration du commentaire cylcique d'une anthropologie de l'imaginaire. Voir les signes ne relève dès lors pas de la seule herméneutique religieuse mais appartient pleinement à une archi-lecture de soi dont l'écriture romanesque serait l'expression, condamnée à se renouveler sans cesse. Le rythme de publication ferait ainsi partie intégrante du rituel, qui tenterait de saisir dans l'instant les scansions souterraines d'une temporalité indépendante, et l'on envisagera ici non seulement de revenir sur les étapes constitutives de cette singularité mais d'observer les inscriptions à venir. Les entretiens et les documents (manuscrits) présents sur le site précédent seront prochainement transférés sur cette page. Luc Vigier (Université de Poitiers, ITEM-CNRS)- Tous droits réservés, 2013.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Littératurefrançaise le 8 Janvier 2014 à 13:06
 Pour un écrivain né dans les symboles en 1959, les années 70 correspondent à une période-socle de constitution identitaire qui hante les écrits de Philippe Le Guillou. L'affectivité des imaginaires cherche ses ancrages, ses territoires tragiques, autour de la fin de l'enfance (12 années, ce sont précisément les années de l'enfance du Christ telle qu'elle apparaît dans un des récits les plus singuliers du corpus narratif): le suicide de Montherlant, le 21 septembre 1972 projette ainsi ses rayons noirs dans les pages d'Après l'équinoxe paru chez Gallimard en 2005, révélant sur fond de désarroi la marque d'un geste définitif, signe récurrent de la clôture sur elle-même d'une époque. Cette date, associée à des lieux parisiens qui passent en boucle également dans Les Années insulaires, c'est le seuil, la marque, la violence d'une mort associée à tout un courant littéraire que Philippe Le Guillou porte en lui et dont les ombres traversent l'oeuvre. La présence de cette "droite littéraire" dans les textes et les romans, associée aux hantises chrétiennes et aux contours d'un érotisme en gestation sont à lire comme les cryptes ou les chiffres d'un séisme intérieur bien plus profond.
Pour un écrivain né dans les symboles en 1959, les années 70 correspondent à une période-socle de constitution identitaire qui hante les écrits de Philippe Le Guillou. L'affectivité des imaginaires cherche ses ancrages, ses territoires tragiques, autour de la fin de l'enfance (12 années, ce sont précisément les années de l'enfance du Christ telle qu'elle apparaît dans un des récits les plus singuliers du corpus narratif): le suicide de Montherlant, le 21 septembre 1972 projette ainsi ses rayons noirs dans les pages d'Après l'équinoxe paru chez Gallimard en 2005, révélant sur fond de désarroi la marque d'un geste définitif, signe récurrent de la clôture sur elle-même d'une époque. Cette date, associée à des lieux parisiens qui passent en boucle également dans Les Années insulaires, c'est le seuil, la marque, la violence d'une mort associée à tout un courant littéraire que Philippe Le Guillou porte en lui et dont les ombres traversent l'oeuvre. La présence de cette "droite littéraire" dans les textes et les romans, associée aux hantises chrétiennes et aux contours d'un érotisme en gestation sont à lire comme les cryptes ou les chiffres d'un séisme intérieur bien plus profond.Avec Les Années insulaires, ce n'est plus seulement la frontière close derrière laquelle surgissent les figures fantasmées des écrivains morts, c'est la plongée d'un oeil précis et coloré sur les quelques années de transition incarnées par la présidence de Georges Pompidou. Le couple du peintre et du politique, soumis à de multiples variations depuis Les sept noms du peintre, se renouvelle ici de manière signifiante: d'un côté Kerros (où les initiés reconnaîtront le nom de Kerrod, lieu central de l'enfance, mais également les sonorités de Perros), peintre de cendres, de l'autre Pompidou, avec toute sa charge culturelle, politique et humaine. La plupart des romans de l'auteur sont habités par cette érotique du pouvoir, attraction du puissant (pape, seigneur, président) pour l'art et fascination de l'artiste pour le pouvoir incarné, d'où qu'en vienne l'assise (religieuse, démocratique, élective, initiatique).
Pourtant, le vrai vivant du dernier roman de Philippe Le Guillou, ce n'est pas le peintre, figure récurrente où l'on reconnaît des traits d'anciens personnages au risque d'un auto-pastiche parfois déconcertant, mais bien Georges Pompidou. Sa présence de chaque instant dans le récit irrigue les thématiques habituelles d'une fraîcheur étonnante, au point que le regard de Pompidou, sa focale instinctive (oeil curieux, mémoire totale, voracité picturale volée au temps présidentiel) semblent féconder l'imaginaire du peintre dont les va-et-vient étranges entre Paris, la Bretagne et Venise (polarités bien connues) sont autant d'exils créatifs animés par l'électricité directe ou indirecte des rares rencontres avec la figure royale de Pompidou.
Et dans Pompidou, la couleur. Le corps présidentiel ouvert sur un prisme au moment du grand éventrement (l'auteur préfère éventration) du plateau Beaubourg livré aux "bétonneurs" et aux architectes du futur centre d'art contemporain dont l'inauguration sera un fiasco. Peint d'abord d'après nature, le président au règne éphémère et frustré, se métamorphose peu à peu, dans la double focale de l'ekphrasis d'une création, en une conscience esthétique isolée au sein des lignes douces et futuristes de Paulin, dans les beiges, les blancs et les bleus Klein. Dans le jeu du peintre et du modèle, où Philippe Le Guillou retrouve la figure obsessionnelle et duelle de Philippe de Champaigne et Richelieu, surgit au coeur du roman une étonnante synergie entre le modèle et la vision qu'il porte sous la forme étincelante de la chambre d'Agam. La figure du peintre s'efface alors pour devenir simple témoin d'une solitude absolue dans le dialogue des couleurs.
Le mystère Pompidou réalisé dans l'alliance des prismes d'aluminium et des désirs inaboutis, au seuil d'une maladie qui dévastera ce qui demeurait en lui d'énergie, c'est à ce moment de l'écriture un passage surréaliste et méditatif qui retourne la vision politique de la période en problématique esthétique et drame intérieur. Le roman lui-même, de page en page, devient plus dense. Après un premier chapitre anecdotique et scandé, le rythme passionnel de l'écriture tend vers la recherche de la tension entre politique et modernité. Le regard de Philippe Le Guillou sur l'incarnation physique d'une nation balaie très rapidement la figure prétexte du peintre pour faire entendre une voix bien différente, celle de l'essayiste et de l'esthète qui n'a cure du roman. Seules lui importent la cristallisation révélée de la cruauté et de l'absolu, l'union multidimensionnelle des pouvoirs de l'art et du politique.
Luc Vigier - Tous droits réservés, 2014.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique